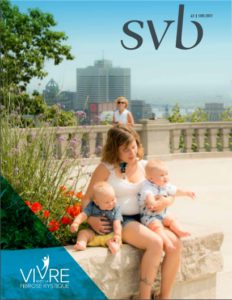Publié dans le SVB2017
Propos recueillis par Tomy-Richard Leboeuf McGregor
Montréal (Québec)
Entrevue avec Véronique Hivon, instigatrice de la loi concernant les soins de fin de vie
Avocate aguerrie, politicienne engagée, mère et passionnée par les questions de justice sociale et de santé, Véronique Hivon est une figure captivante du milieu politique québécois. Diplômée en droit à l’Université McGill en 1994, elle poursuivra ensuite ses études à la London School of Economics and Political Science, en Angleterre, où elle approfondira ses connaissances sur le rôle que peuvent avoir les mesures sociales dans la collectivité.
Celle qui est souvent définie comme une anti-politicienne peut se targuer d’être tout aussi populaire et appréciée chez les sympathisants de sa formation politique qu’auprès de la population et de plusieurs adversaires. Entrée en politique avec la conviction qu’il fallait changer les choses de l’intérieur, elle devient députée de Joliette en décembre 2008. En 2012, alors membre du conseil des ministres, elle dépose le projet de loi 52, intitulé Loi concernant les soins de fin de vie.
Entrevue avec une politicienne qui a su piloter un dossier épineux, qui a provoqué des discussions importantes auprès des personnes vivant avec la fibrose kystique et de la population québécoise dans son ensemble.
Madame Hivon, pourquoi vous êtes-vous lancée en politique?
J’ai d’abord occupé des postes d’attachée politique auprès de deux ministres, puis j’ai travaillé comme avocate pour le gouvernement du Québec. Je m’impliquais également comme militante au sein de mon parti et plusieurs personnes me disaient que j’avais les qualités nécessaires pour passer au-devant de la scène. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup rencontrer les gens et exprimer mes points de vue. Avec le temps, j’ai voulu développer mes propres habiletés professionnelles et aller au bout de mon engagement.
Trois raisons profondes m’ont définitivement convaincue à me lancer. D’abord, je sentais que la nouvelle génération devait prendre sa place en politique. Vous le savez, je suis indépendantiste et il est important pour moi qu’on renouvelle notre discours. Puis, la question de la justice sociale m’interpellait et j’estimais qu’il fallait en faire une priorité. Enfin, j’ai fait le saut car je voulais changer les choses de l’intérieur. C’est un thème fort de mon engagement, je sais qu’il y a une réelle déconnexion entre les citoyens et la politique. Cette déconnexion, je la comprends : les gens ne veulent plus voir les politiciens agir dans le moule traditionnel. J’avais la volonté de changer les choses !
Aux élections de 2012, vous êtes réélue députée de Joliette et vous faites votre entrée au sein du gouvernement du Québec. Quelles étaient alors vos responsabilités ?
La première ministre du Québec, Pauline Marois, m’a confié plusieurs responsabilités. D’abord, j’ai été nommée Ministre déléguée aux Services sociaux et ministre responsable de tout ce qui entourait les questions de soins de fin de vie. J’étais également ministre responsable de ma région, Lanaudière. Il faut savoir que le ministère des services sociaux est une grosse responsabilité, ce sont plus de 7 milliards de dollars qui lui sont attribués. Son rôle est très important car il touche toutes les sphères du bien-être des personnes, que ce soit celles ayant une déficience physique, les personnes autistes, celles qui souffrent de toxicomanie ou celles qui sont dans une situation d’itinérance, sans oublier le dossier de la protection de la jeunesse. En bref, tout ce qui touche de près ou de loin aux questions sociales. Comme vous pouvez le constater, c’était diversifié !
Le 12 juin 2013, à l’Assemblée nationale, vous déposiez le projet de la 52, intitulé Loi concernant les soins de fin de vie. D’où vous en était venue l’idée ?
C’est une idée que j’avais mise de l’avant dès le début de mon engagement politique, et ce pour plusieurs raisons. Durant mes études en droit, j’avais compris l’importance de l’autonomie de la personne afin qu’elle puisse elle-même décider de son sort. J’ai lu beaucoup de jurisprudence sur le sujet, notamment le célèbre cas de Sue Rodriguez. Atteinte d’une maladie incurable, elle s’était lancée dans une longue bataille juridique en 1992, revendiquant le droit de mourir dans la dignité en obtenant l’aide d’un médecin. Elle avait alors fait appel à la Cour suprême du Canada. Les juges, dans un résultat très serré (5 contre 4), avaient refusé d’accéder à sa demande. J’avais également eu la chance de suivre des cours en éthique médicale.
Et puis, j’ai moi-même été confrontée à cette situation, car des gens proches de moi, en fin de vie, ont beaucoup souffert. J’ai également connu des gens qui ont eu accès à des soins de fin de vie exceptionnels. Pour toutes ces raisons, j’ai eu à de multiples occasions et à différents moments le temps et le besoin de réfléchir à cette question.
Politiquement, je croyais essentiel que les élus se penchent sur cet enjeu. Il ne fallait pas attendre que les tribunaux viennent tracer la voie, en faveur ou non, d’un projet en ce sens. Je suis convaincue que pour des sujets si délicats, il faut se retrousser les manches et travailler avec la population. Les élus doivent oser s’attaquer à ce type de dossier plutôt que de s’en laver les mains parce que ce sont des questions difficiles qui peuvent froisser une partie de l’électorat. Nous devons assumer nos responsabilités!
Plusieurs personnes se sont opposées à l’aide médicale à mourir. Comment avez-vous réussi à établir un large appui de la part de la population ?
D’abord, nous avons pris tout le temps qui était nécessaire pour mener à bien diverses consultations. Pour des enjeux d’une telle importance, il est impératif de se donner les moyens de réussir. Quand on essaie d’instaurer d’importants changements sociaux et humains, il faut être au diapason de la population. En travaillant bien à toutes les étapes, on peut arriver à bâtir le consensus nécessaire.
Je dirais également que nous avons été à même de travailler de façon non partisane. Nous avons mis sur pied une commission qui est allée à la rencontre des gens dans différentes villes du Québec. Il faut se rappeler que l’enjeu ne concernait pas uniquement l’aide médicale à mourir, il était aussi question de l’ensemble des soins de fin de vie. Nous devions nous interroger sur comment accompagner au mieux les personnes dans cette situation que nous vivrons tous un jour. Ce projet concernait donc également les soins palliatifs ou les directives anticipées, par exemple. Je crois que cela a beaucoup rassuré une partie de la population, nous voulions vraiment que les personnes concernées par ces soins soient au cœur de la prise de décision.
De l’avis d’une majorité de la population, ce projet de loi était devenu incontournable et constituait une réelle avancée pour la société. C’est pourquoi nous voulions à ce point travailler collectivement : il fallait que ce projet soit une réussite. Des gens de tous les milieux y ont mis leur grain de sel, contribuant ainsi à faire améliorer positivement notre démarche. Ainsi, même les personnes qui étaient a priori contre ce projet n’y étaient plus réfractaires à la fin.
Le fait de s’accorder tout le temps dont nous avions besoin nous a également permis de bien diffuser notre message dans les médias. Tous les enjeux médicaux, juridiques ou éthiques qui étaient soulevés furent relayés à la population et débattus, permettant de faire cheminer progressivement les personnes qui avaient encore des réticences.
Quelles sont les différences principales entre l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs ?
Quand on parle de soins palliatifs, il est question de soulager tant les souffrances physiques que morales de la personne, mais également de son entourage. Il s’agit de traiter la personne dans une approche globale et holistique, en tenant compte de l’ensemble de ses besoins pour qu’elle se sente bien. Il n’est donc pas question de provoquer la mort, mais bien d’accompagner sereinement la personne en fin de vie.
Concernant l’aide médicale à mourir, il s’agit d’un élément pour une situation exceptionnelle, bien précise, dans les cas où, malgré les meilleurs soins à notre disposition, nous ne pouvons pas arriver à soulager toutes les souffrances subies. Cela entraîne beaucoup de détresse physiologique et psychologique. Ainsi, grâce à l’aide du personnel médical, la personne peut partir sereinement selon ses volontés, et mettre fin à des souffrances intolérables, lorsque cela n’a plus de sens pour elle.
Le gouvernement fédéral a été obligé, par la Cour Suprême, à autoriser l’aide médicale à mourir partout au Canada. Est-ce qu’il y a des différences entre la loi québécoise et la loi canadienne ?
Oui, il y a quelques différences qui sont importantes. La loi fédérale permet deux formes d’aide médicale à mourir, puisqu’elle inclut également le suicide assisté. Au Québec, la mort se donne par une injection administrée par un médecin : c’est le monde médical qui agit. Au niveau fédéral, il peut y avoir des cas où c’est la personne elle-même, par un autre protocole, qui s’administre la mort. Concrètement, au Québec, nous avons fait le choix d’inscrire l’aide médicale à mourir comme étant un service prodigué à l’intérieur du système de santé, dans un «continuum» des soins de fin de vie. L’autre aspect est qu’au fédéral, une personne avec un lourd handicap pourrait demander à y recourir, alors qu’au Québec seules les personnes atteintes d’une maladie grave et incurable et qui sont en fin de vie, peuvent la demander.
Le moment où on peut y recourir est également différent. Dans notre loi, nous avons inscrit que la personne doit être en fin de vie, mais nous n’avons pas défini de période précise afin de disposer d’une certaine marge de manœuvre et de permettre que chaque situation puisse être interprétée à la lumière de différents critères. On peut penser qu’il s’agit habituellement d’une espérance de vie de moins d’une année. Au fédéral, ils ont opté pour une définition plus large, celle de la mort raisonnablement prévisible. Il y a encore beaucoup de débats pour définir exactement ce que signifie cette expression, mais de façon générale, nous croyons que cela couvre une période plus large que celle de la fin de vie.
Il y a également quelques différences techniques : du côté fédéral, on demande un délai de 15 jours entre la demande et l’accomplissement de l’acte. Alors qu’on sait qu’une seule journée est une éternité pour une personne souffrante et en fin de vie, je trouve que cette différence est malheureuse.
Il est important de dire que notre loi a été pensée afin que nous demeurions dans notre champ de compétence exclusif qu’est la santé. Le Québec n’est donc pas tenu de suivre ces différences.
Vous êtes souvent citée en exemple pour l’aspect non partisan de votre démarche. Croyez-vous que c’est ce qui a permis l’adhésion de la majorité des députés et de la population à ce projet de loi ? Croyez-vous que cette façon de faire pourrait améliorer le climat des délibérations à l’Assemblée nationale ?
Oui, l’aspect non partisan a été la pierre angulaire de ce succès. Les gens sentaient que les élus de toutes les formations politiques travaillaient pour l’intérêt supérieur de la population, pour l’avancement de la société. Souvent, à la fin des consultations, des gens venaient me dire que cette démarche les avait réconciliés avec la politique ! Ils trouvaient beau de voir les députés travailler ensemble, en collaboration. Plusieurs ont même souligné que parfois, on ne pouvait même pas savoir qui était de quel parti politique ! Le débat n’a pas été pollué par la volonté de faire des gains politiques.
Par ailleurs, je pense évidemment qu’il faudrait travailler de la sorte plus souvent. De manière générale, les élus devraient éviter la petite partisanerie, au sens négatif du terme. Je crois bien sûr que nous devons faire de la politique avec des convictions fortes, qu’il faut des points de vue divergents, car c’est avec des débats d’idées que l’on peut faire progresser la société. Quand on va en politique, c’est pour se battre pour un idéal! Cependant, je crois que lorsqu’on parle de questions sensibles, nous devrions travailler sans partisanerie, avec le bagage et les idées de tout un chacun. C’est toute la société qui y trouve son compte, car le débat est constructif et il nous permet d’aller au cœur des enjeux.
Outre l’aide médicale à mourir, est-ce qu’il y a d’autres réalisations dont vous êtes particulièrement fière ?
Je suis très heureuse d’avoir mis sur pied la première politique de lutte à l’itinérance et du travail que j’ai accompli en tant que ministre pour aider les personnes souffrant de déficiences ou du spectre de l’autisme. Ce furent de petits pas et il reste beaucoup à faire, mais il y a eu de ma part une volonté de bonifier les ressources, particulièrement pour les personnes de plus de 21 ans qui subissent parfois une rupture de services.
Mais au-delà de tout, je suis particulièrement fière de tout le travail que j’accomplis quotidiennement dans ma circonscription, en tant que députée de Joliette. Lorsque je dois aider une personne à obtenir son chèque d’aide sociale ou qui a un problème avec la CSST, une personne qui est désemparée ou une autre qui vit une situation difficile, je trouve un sens à mon rôle d’élue.
Selon vous, quelles devraient être les priorités en matière de santé et de services sociaux dans les années à venir ?
C’est une très vaste question ! Il y a tellement d’enjeux…
D’après mon expérience passée en tant que ministre déléguée aux Services sociaux, j’aimerais que nous bâtissions une approche beaucoup plus globale lorsque nous aidons une personne qui est malade ou qui vit de graves problèmes. Je crois qu’il faut s’assurer d’éliminer le plus possible la compartimentation des services et de la délivrance des soins. C’est très difficile pour quelqu’un d’avoir une prise en charge complète qui a du sens. On s’occupe de l’aspect médical, ensuite un travailleur social peut venir s’occuper d’autres choses. Souvent, les intervenants ne se parlent pas beaucoup.
Il faut maintenant inverser la pyramide. Plutôt que de partir du service et de l’imposer à la personne, nous devrions partir de la personne et faire un plan de match adapté à ses besoins. Il nous faudrait également plus de ressources pivots qui seraient toujours en relation avec la personne concernée. Cela assurerait la fluidité et une meilleure efficacité des services qui sont donnés.
Il nous faut aussi mieux reconnaitre l’importance des services sociaux. Je dis souvent que ce n’est pas parce qu’on ne saigne pas qu’il n’y a pas une urgence! Par exemple, nous mettons souvent l’emphase sur les interventions à la hanche, aux cataractes ou aux genoux, pour lesquelles nous nous sommes donnés des objectifs chiffrés, avec un rendement à atteindre. Ces cibles sont évidemment très importantes, mais nous ne les retrouvons pas pour beaucoup trop de maladies ou de réalités sociales, comme la toxicomanie ou chez les personnes qui sont en situation d’itinérance. Sans ces objectifs, ces personnes sont parfois oubliées et les ressources attribuées ne sont pas adéquates.
Madame Hivon, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue!