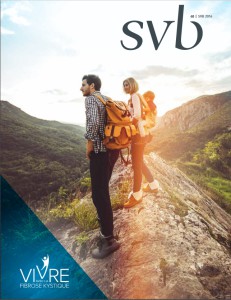Témoignage d’Annie Dubreuil
Brossard (Québec)
Extrait du SVB2016
J’ai six mois lorsque le diagnostic tombe. Au début des années 1980, le pronostic n’est guère encourageant pour l’avenir des enfants atteints. Malgré tout, mes parents décident de faire un pied de nez à la réalité. C’est-à-dire, ils vont tout faire en leur capacité pour avoir une enfant fibrose kystique en santé.
La maladie fait partie de moi sans toutefois me définir. À la base, je reste, du moins aux yeux de mes parents, une enfant comme tous les autres avec un éventail de possibilités, d’aptitudes à développer et surtout d’un avenir à bâtir. Sans éprouver de haine envers la vie ou la maladie, je ressens tout de même un important complexe d’infériorité par rapport aux gens en pleine santé. Cette impression m’incite à pousser plus loin pour me prouver à moi-même et aux autres que malgré l’handicap je suis une personne respectable qui a quelque chose à apporter à la société. Venant d’une famille où la performance et la réalisation de soi sont valorisées et encouragées, la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Je carbure à cette même essence. J’aime vivre dans l’action. Vivre au jour le jour, trop peu pour moi. Les projets, les défis et surtout les résultats me nourrissent.
Malgré la maladie, tout demeure possible, moyennant la planification d’un plan A, B et parfois C. Je réussis à obtenir une bourse pour étudier dans une grande université parisienne, voyager dans des endroits reculés en passant par la Russie, l’Uruguay, le Groenland et les Galapagos, pour ne nommer que ceux-là, marcher les 170 kilomètres avec d’importantes dénivellations entourant le Mont-Blanc (une de mes plus grandes fiertés), me balader à travers l’Europe seule avec mon sac à dos, avoir un amoureux et un beau groupe d’amis. Nul doute, la vie était bonne pour moi. Longtemps, je tiens ma santé pour acquise et crois que j’ai la capacité de contrôler la maladie. Les statistiques, c’est pour les autres. Quant à moi, je vais les défoncer!
Vers l’âge de vingt et un ans alors que je termine ma dernière année de bacc en économie à l’Université Concordia dans un programme Co-op, les choses basculent pour la première fois. Par le passé, j’ai connu les hospitalisations, mais jamais une décompensation aussi rapide et importante.
Alors que je réussis à jongler avec succès avec les études, le travail et la vie de couple, les choses prennent un virage inattendu. En quelques semaines, mes fonctions pulmonaires passent de 113 % à 37 %. Littéralement, je vois des étoiles. Je compte mes pas entre mes déplacements. Diagnostique : Surmenage.
Évidemment, il s’en suit d’une longue hospitalisation. Heureusement, mes fonctions remontent à 94 % et la vie reprend son cours.
Sans le savoir encore, la maladie vient de se réveiller et je suis embarquée dans les montagnes russes de la maladie. Mon diplôme de baccalauréat en poche, j’entreprends ma maîtrise en Science économique et la termine quatorze mois plus tard en collectionnant les nuits blanches à étudier et les infections. Alors que je vise toujours la performance, je n’ai visiblement rien compris. Avant même de mettre le dernier point à mon rapport de maîtrise, une société d’État, où j’ai fait plusieurs stages durant mes études, me propose un emploi dans mon domaine. Je suis plus que ravie de me voir offrir une telle opportunité. Mon travail me valorise, me donne un statut et une santé financière confortable. Avec le travail, la routine quotidienne est établie au quart de tour. Entre les traitements, le clapping que j’ai dû reprendre, l’exercice, le travail et le trafic, il me reste très peu de temps libre. La plupart des fins de semaine, je les passe à dormir pour reprendre des forces et à rêver à mes prochains voyages.
J’ai beau avoir une hygiène de vie très stricte et suivre les traitements à la lettre, n’empêche que la maladie continue de faire son chemin et me fauche environ dix pour cent de fonction respiratoire par année. Avec du recul, le plus judicieux aurait sans doute été de diminuer ma charge de travail. À l’époque, je n’en fais pas une option. Si les gens en santé sont capables de travailler à temps plein, alors moi aussi.
J’ai beau tousser, cracher et vomir ma vie tous les matins, je vais au bureau. J’ai sans doute poussé un peu le sens des paroles de la chanson d’Henri Salvador disant que le travail est la santé. Peut-être, mais à quel prix? Puis, je fais un premier pneumothorax nécessitant un talcage pleural. Avant de quitter l’hôpital, le chirurgien me dit une phrase qui m’ébranle. « Annie, je ne peux pas dire si ce sera dans deux ans, cinq ans ou dix, mais un jour tu seras une bonne candidate pour la greffe. N’oublie pas de venir me voir avant qu’il ne soit trop tard. » Je reçois le conseil comme une gifle. Je ne suis pas prête à en faire une option. À mes yeux, mes difficultés sont encore temporaires. Mes poumons vont remonter. Ça ne peut que faire autrement. Puis les choses semblent vouloir se calmer pendant un temps. J’ai l’impression de reprendre le contrôle.
Le calme avant la tempête
Au début de l’année 2009, je pique du nez. J’aime croire que c’est la beauté des sapins de Noël de Prague qui m’ont coupé le souffle. En vol vers la maison, je sais que ce sera mon dernier voyage pour un long moment. Mon corps ne suit plus, mes poumons encore moins. J’entre d’urgence à l’hôpital pour soigner une pneumonie. À l’admission, mon premier appel va à mon patron pour lui dire que je dois m’absenter deux semaines pour des traitements. J’en fais une priorité de retourner travailler rapidement.
Après trois semaines de traitements, mes fonctions ne montent guère plus haut qu’un pauvre 31 %. Bien que je la voie venir depuis quelque temps, la réalité me frappe de plein fouet. La greffe pulmonaire devient maintenant une réalité. Au rythme où mes fonctions déclinent, c’est à se demander si je vais pouvoir tenir les deux ans d’attente estimés jusqu’à l’appel. Au pied du mur, je n’ai pas eu d’autre choix que de réévaluer mes priorités. Est-ce que je privilégie encore un emploi au détriment de ma santé? J’aime trop la vie pour ne pas me donner une chance. Je me dois de suivre les conseils de mes médecins.
C’est ainsi que je me retrouve en arrêt de travail. Pendant un moment, j’ai l’impression que le ciel m’est tombé sur la tête. Je perds mes repères, mon statut, et surtout mon identité. En dehors de mon travail et de mes voyages, qui je suis? Qu’est-ce qui me définit et m’allume? Je n’en ai pas la moindre idée. Même avec mon nom sur la liste de greffe, j’ai encore espoir de voir le vent tourner et de pouvoir repousser l’opération de quelques années supplémentaires.
Entre-temps, il est hors de question que je gaspille mes journées à regarder la télévision sur mon sofa et à envier tout le monde en santé autour de moi. Puisque je suis forcée de prendre une pause, aussi bien utiliser ce temps à bon escient pour découvrir ce que je veux vraiment de la vie. Ruminer mes incapacités m’est trop lourd. J’aime mieux mettre l’accent sur ce qui m’est encore possible. Passer drastiquement d’un mode action à un de contemplation n’est pas toujours évident ni même naturel pour moi. Munie de ma bonbonne d’oxygène, je me suis mise au yoga et à la méthode pilates avec des groupes pour retraités. Les bienfaits se sont fait sentir autant physiquement que mentalement. Pour occuper mon temps, ma dent sucrée m’amène vers des cours de pâtisserie. Mes desserts sont fabuleux à l’œil, plus ou moins aux goûts. J’essaie la peinture, les cours de russe et de photos. L’intérêt y est, mais ma petite flamme intérieure ne semble pas tout à fait vibrer. Puis par un beau matin d’été, le facteur laisse une publicité dans ma boîte aux lettres annonçant les cours de soir offerts à l’École nationale de l’humour. Je le prends comme un signe. En plus d’y apprendre les rudiments de l’écriture d’une bonne blague, les soirées à l’école me servent d’échappatoire au quotidien. Le rire devient ma thérapie. Comme une révélation, je me découvre un certain talent pour raconter et un intérêt tout particulier pour l’écriture. C’est ainsi que je me laisse tenter par l’écriture d’un premier roman. Derrière mon clavier, je me sens vibrer comme je ne me suis pas sentie depuis un bon moment. En plus de me divertir, l’écriture nourrit mon besoin de valorisation et se pratique très bien pendant les interminables traitements d’aérosol et d’intraveineux.
À l’heure où j’écris ces lignes, je suis fraîchement greffée depuis quelques semaines. L’attente se sera étendue sur un peu plus de six années, donc trois durant laquelle j’ai été en antibiothérapie par intraveineux en continu. En plus des surinfections à répétitions, j’ai eu un pneumothorax majeur qui aura presque compromis la greffe et des hémoptysies nécessitant une embolisation. Bien que l’attente aura apporté son lot d’incertitude, de difficulté et de moments de grandes angoisses, ce sera aussi une belle période de retour à la base. En plus d’avoir utilisé ce temps pour écrire et publier six romans dont j’ai aimé chaque moment de création, j’ai redéfini mes priorités, fait du ménage dans ma garde rapprochée et passé du temps de qualité avec les gens que j’aime et qui m’aime dans toute ma simplicité pour l’être que je suis et non pour ce que j’ai à leur apporter.
Somme toute, s’il y a deux choses que je souhaite maintenant, c’est de rester en santé pour passer le plus de temps avec mes proches et de ne pas me laisser retomber dans le tourbillon de la performance à tous prix.
Parfois, l’humain a la mémoire courte!